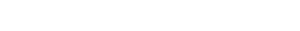J’ai tout mis dans des boîtes à chaussures que j’ai été porter dans la cour. J’ai imbibé le carton de combustible à fondue et j’ai allumé. Le feu a été long. En voyant les couleurs qui montaient du bûcher, mes yeux se sont embués. Ce bleu-vert qui fendait l’air, était-ce le polaroid de ma confirmation ? Quelle fête ancienne expirait de ce grésillement ? J’avais la gorge serrée : je tuais quelque chose. Je pleurais mes traces.
N’y a-t-il pas pour chacun de nous, quand nous avons vécu assez longtemps, un moment où nous prenons conscience que la vie est finie ? Non pas que la mort soit imminente, mais que la vie est finie, comme on le dit d’un ensemble fini. Que faire alors des objets que nous avons accumulés et qui seront peut-être les seuls témoins de notre passage sur terre ?
N’y a-t-il pas pour chacun de nous, quand nous avons vécu assez longtemps, un moment où nous prenons conscience que la vie est finie ? Non pas que la mort soit imminente, mais que la vie est finie, comme on le dit d’un ensemble fini. Que faire alors des objets que nous avons accumulés et qui seront peut-être les seuls témoins de notre passage sur terre ?
« La prose de Michael Delisle aime se poser sur le vertige du gouffre, ces traces d’enfer que chacun porte en soi. »
Odile Tremblay, Le Devoir
12.95 $ / 10.00€
Les Éditions du Boréal
3970, rue Saint-Ambroise, Montréal (Québec), Canada H4C 2C7
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.