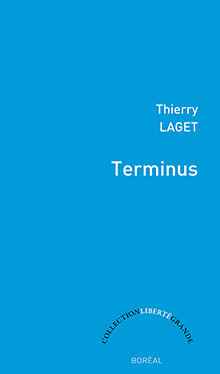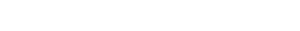Ce soir-là tout se terminera. Le monde va disparaître. Monsieur Dimanche, gardien de nuit dans un hôtel de bord de mer, observe la marche des heures qu’il reste à l’univers avant que le temps s’arrête à jamais – la télévision ne parle que de cela, mais la panique ne semble encore gagner personne. Dimanche se souvient des voyages, des musiques, des amours : il lui reste un dernier mystère à éclaircir. Sur la table du petit déjeuner, laissé là par un romancier mégalomane, un manuscrit, Terminus. Sous ce titre, Thierry Laget, en surplomb et détachements, signe un livre délicat et circonspect rassemblant, dans un éclat de rire, d’élégiaques cérémonies d’adieu à ce qui fut parfois si beau et qui ne sera plus – les chats, les peintres miniaturistes d’Ispahan, les tulipes d’Istanbul, les poètes, les phénix…
23.95 $ / 19.00€
Les Éditions du Boréal
3970, rue Saint-Ambroise, Montréal (Québec), Canada H4C 2C7
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.